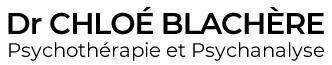Qu’est-ce que l’inhibition ?
L’inhibition et les multiples formes qu’elle peut revêtir ont été étudiées par Sigmund Freud en 1925. Cette étude a donné lieu à la publication de son ouvrage Inhibition, symptôme et angoisse (1). Freud y parcourt ce qui lie l’inhibition à l’angoisse, et la manière dont l’organe faisant l’objet d’une inhibition a d’abord été le lieu d’un fort investissement libidinal (2).
L’inhibition et ses déclinaisons
Pour certaines personnes, qui se sont habituées depuis des d’années à contourner l’objet de leur inhibition, elle peut même, dans un premier temps, ne pas leur sembler associée à une souffrance psychique. Pour d’autres au contraire, elle oblige à tant de contorsions que devant un quotidien devenu invivable et des stratégies de contournement qui ne sont plus opérantes, l’urgence d’aller consulter se fait première.
Pour d’autres encore, ce qui avait été pris pour une singularité, une forme d’introversion ou d’intériorité, leur apparaît soudainement comme une forme d’inhibition avec laquelle ils ne sont dès lors plus près à continuer à vivre.
En effet, c’est d’abord l’inhibition qui conduit un être à ne pas faire une action, ou à prendre la parole, à un moment où il sait qu’il devrait faire cette action ou dire ce qu’il a à dire. Les raisons qui peuvent être évoquées à cette inhibition sont bien souvent la peur de dire, la peur de ne plus être aimé, la peur d’être rejeté, ou encore la peur d’être seul.
L’inhibition : répercussions et perspectives
Les inhibitions qui découlent de telles peurs comportent un prix à payer pour l’être. Certains n’hésitent pas à qualifier leurs propres comportements d’inhibition comme étant une manifestation de leur lâcheté, lâcheté qui concerne avant tout leur rapport à eux-mêmes. Ce prix se paie alors sous forme de souffrances, que celles-ci soient psychiques ou corporelles.
S’engager dans un travail de psychothérapie puis de psychanalyse constitue, pour ceux qui souffrent de telles inhibitions, le lieu d’une exploration qui, au moyen de l’association libre des pensées, ouvre à la possibilité de dénouer les conflits psychiques qui avaient abouti à de telles formations symptomatiques.
(1) FREUD, S. (1925). « Inhibition, symptôme et angoisse », in Œuvres complètes, vol. XVII, Paris, PUF, 1992, pp.203-286.
(2) Blachère, C. (2020). « L’inhibition et ses répercussions dans l’existence », https://www.chloeblachere.com/2020/12/22/linhibition-et-ses-repercussions-dans-lexistence/
Dr Chloé Blachère
Psychothérapie et psychanalyse à Paris 18è